Regard critique sur les conclusions du Rapport de la Commission Ramondy sur l’histoire du Cameroun entre 1945 et 1971
Un regard critique sur le rapport remis le 28 janvier 2025 au président camerounais Paul Biya par la commission franco-camerounaise dite Commission Ramondy, sur le rôle de la France dans la guerre de décolonisation du Cameroun entre 1945 et 1971.
Professeur Ahmadou Sehou, Enseignant-chercheur en histoire politique et sociale
3/16/202516 min lire
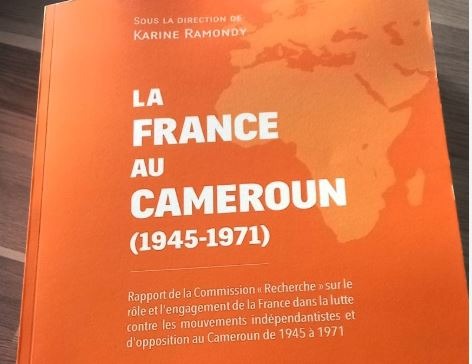
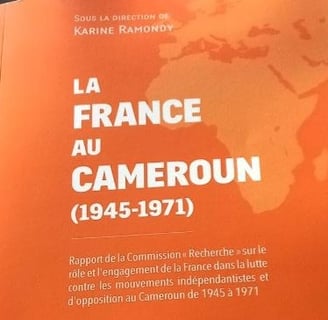
Considérations d’ordre général : une manœuvre stratégique française
Pour comprendre ce qu’il est convenu d’appeler la Commission Ramondy sur l’histoire du Cameroun, il faut considérer sa genèse et sa mission. Pour cela quelques faits saillants méritent d’être rappelés : en mai 2009, le Premier Ministre de la France d’alors François Fillon est en visite à Yaoundé. Interrogé sur les évènements de1955 à 1971 et la rétention des archives de cette période par la France, il les qualifia de « pure invention ». Il fallut attendre la visite à Yaoundé du Président Français François Hollande en juillet 2015, pour que ce dernier reconnaisse devant la presse « qu’il y a eu des épisodes tragiques dans l’histoire. Il y a eu une répression dans la Sanaga-Maritime, en pays bamiléké et je veux que les archives soient ouvertes pour les historiens ». Cette promesse ne mit pas fin à la querelle et ne combla pas les attentes de tous ceux qui espéraient une nouvelle ère dans les relations entre la France et le Cameroun au sujet de cette période marquante de l’histoire des deux pays. En visite au Cameroun en 2022, le Président Français, Emmanuel Macron, à la demande de la société civile camerounaise, promit la mise en place d’une commission mixte France-Cameroun chargée de dégager la responsabilité de la France dans les évènements des années 50 et 60 au Cameroun. La Commission promise fut mise en place de manière unilatérale par la France dans la foulée, suscitant de vives polémiques dans sa composition, financée et contrôlée de bout en bout par la partie française, avec certains de ses membres bien éloignés de la question, alors qu’il existe à travers le monde des personnes oubliées, ayant abondamment travaillé sur cette thématique.
La controverse se renforce par le privilège accordé à l’école historique de Yaoundé dont la sympathie pour l’UPC et l’hostilité à l’égard des autres nationalistes camerounais est de notoriété publique et particulièrement à l’égard d’Ahmadou Ahidjo pourtant un acteur principal et important de la période concernée. Dans une vision binaire en faveur exclusivement de l’UPC, toute posture différente ou autre voie étant considérées comme collaborationniste et favorables au colonisateur, des générations d’historiens ont été formés à devenir des sympathisants de l’UPC et des adversaires de tous ceux qui avaient choisi d’autres stratégies (soit vous êtes du côté de l’UPC, soit vous êtes un collabo). Pourtant, entre l’Upécisme radical et l’extrêmisme d’André-Marie Mbida, il y avait place pour l’expression de plusieurs autres positionnements sur l’échiquier politique camerounais. La constitution de l’équipe exclura sans surprise d’autres sensibilités, en l’occurrence les experts de la partie septentrionale du Cameroun, alors même que la responsabilité d’Ahmadou Ahidjo est questionnée dans la période allant de 1958 à 1971, privant la Commission d’une analyse plus équilibrée au regard de la manière dont cet acteur de l’histoire a été brocardé par l’historiographie produite essentiellement par les originaires du Cameroun méridional.
C’est donc dire que dès son origine, cette Commission asymétrique avait une mission qui a évolué sans pour autant apporter plus de clarté dans les objectifs qui lui étaient assignés. S’agissait-il de rendre accessibles toutes les archives de la période aux chercheurs et historiens ? S’agissait-il d’écriture de l’histoire de la période à partir de certaines archives mises à disposition par la France par un Comité d’historiens choisis ? Qu’en est-il du rapatriement de ces archives au Cameroun ? Sa composition fut dès le départ contestée et contestable, malgré tous les gages de bonne volonté exprimés par ses membres et leur « indépendance » proclamée. De ce fait, plusieurs interrogations l’ont accompagnée dans sa méthodologie, ses sources, ses angles d’analyse et ses finalités : revient-il à la France d’écrire l’histoire peu glorieuse de sa présence au Cameroun et de la manière dont elle a réprimé les forces nationalistes locales ? Revient-il à la France d’établir sa responsabilité dans des faits où elle était au-devant de la scène ? Revient-il à une puissance coloniale d’écrire et d’établir ses crimes au Cameroun ? Les historiens embarqués et grassement payés par la France peuvent-ils prétendre à l’objectivité et à l’indépendance d’analyse, alors même que le commanditaire et le coupable cherche à redorer son blason en Afrique en soldant avantageusement son passif colonial ? L’analyse des conclusions du rapport nous édifiera certainement dans toutes ces directions.
Des conclusions du rapport
Après près de deux années de recherches et de rédaction, la Commission Ramondy sur l’histoire du Cameroun a rendu son rapport, d’abord à son principal commanditaire, le Président français, Emmanuel Macron, ensuite au Président camerounais, Paul Biya et enfin, au grand public. Le format du rapport en lui-même questionne et suscite interrogations. S’agit-il d’un rapport sur la responsabilité de la France, indiquant clairement son rôle et les donneurs d’ordre dans ce qui est devenu la guerre du Cameroun à partir des archives déclassifiées ou d’un livre sur l’histoire du Cameroun ? Malgré son nom de « Rapport », ce qui a été rendu public est un volumineux ouvrage, présentant une synthèse historique de plus de mille pages en deux volumes ainsi que des annexes. C’est ce que les auteurs du rapport appellent eux-mêmes « une histoire globale d’une guerre de décolonisation encore trop méconnue » (Ramondy, 2025, p. 1051). Est-ce ce qui avait été commandé ? Loin de là ! Pour l’historiographie c’est une remarquable contribution. Pour les réponses nouvelles apportées, il y a lieu de convenir, très peu de choses pour être gentil. Car tout semble converger vers un détournement de mission, pour justifier la commande dans un volumineux travail que très peu de personnes auront le temps de lire et faire croire que toutes les réponses attendues s’y trouvent, à condition de se donner la peine de parcourir les mille pages ! De l’accès aux archives nouvelles, nous sommes arrivés à un ouvrage d’érudition, revisitant toute la bibliographie relative à la période considérée. En lieu et place d’un rapport qui situe clairement les responsabilités à partir des archives jusque-là inaccessibles, nous avons un livre d’histoire du Cameroun sur la période 1945-1971. Pire, les archives consultées n’ont été rendues disponibles que pour les membres de la Commission à la suite de démarches et formalités bureaucratiques nombreuses et vexatoires, malgré la commande officielle !
Malgré son statut de commande officielle des deux Etats concernés, les auteurs du rapport-livre relèvent eux-mêmes qu’ils n’ont pas pu accéder à toutes les archives de la période. Du côté français comme camerounais, certaines de leurs demandes n’ont pas reçu de réponses favorables. Non pas pour une quelconque indisponibilité mais par refus volontaire de leur permettre d’y accéder. La partie camerounaise a brillé particulièrement par ses obstructions ou sa faible coopération. Les membres de la Commission Ramondy n’ont pas pu exploiter les fonds d’archives des Archives Nationales du Cameroun, du Ministère des Relations Extérieures, de la Sûreté Nationale, du Ministère de la Défense ou des Services du Gouverneur du Littoral entre autres (Ramondy, 2025, vol. 1, p. 11). A se demander finalement à quoi a consisté le travail de la Commission au niveau du Cameroun et pourquoi les autorités camerounaises se sont-elles montrées si hostiles à ce qui paraissait être une occasion d’histoire et de vérité.
On peut logiquement se demander ce que les deux parties nous cachent encore, quelles sont leurs craintes et surtout à quel horizon envisagent-elles ouvrir définitivement toutes ces archives à tous les chercheurs et personnes intéressées. A l’endroit de la partie française, quand est-ce qu’elle rendra au Cameroun ses archives conservées ou emportées lors du départ de son personnel colonial ? Ce sont des préalables importants pour clôturer cette séquence historique, en permettant un accès universel aux archives du Cameroun ou sur le Cameroun. C’est à ce prix que toutes les suspicions pourront être levées ou qu’une véritable histoire des rapports franco-camerounais pourrait être écrite. Encore que demeurera un soupçon de rétention préalable ou de destruction des pièces fondamentales.
De la place d’Ahidjo dans l’histoire du Cameroun
Malgré son érudition, au regard du nombre de sources consultées et exploitées, ce rapport-livre est demeuré tributaire de la lecture de l’histoire sous le prisme des adversaires d’Ahidjo, se réclamant essentiellement de l’UPC comme sympathisants ou militants en exil. Il est difficile de comprendre cette affirmation reprenant cette idée selon laquelle « La réussite d’Ahidjo au pouvoir est assez surprenante, il apparaît comme un véritable outsider que rien ne prédestinait à une carrière politique aussi longue. » (Ramondy, 2025, vol. 2, p. 591). Cela traduit clairement l’absence d’une réflexion et d’une analyse profonde de l’émergence politique d’Ahidjo et du contexte qui l’a vu évoluer. Pour qui s’est attardé un tant soit peu sur le parcours d’Ahmadou Ahidjo, il est évident de reconnaître son ascension méthodique qui l’a conduit à réaliser ce destin qu’on lui connaît. Loin d’être un homme sorti de nulle part et qui par un accident de l’histoire est parvenu à se faire un nom, l’évolution politique d’Ahmadou Ahidjo est un cas d’école.
Un engagement politique précoce dans un environnement hostile
Ahidjo a d’abord fréquenté l’école coranique avant d’aller à l’École Régionale de Garoua créée par l’administration coloniale en 1920. Après ses études primaires sanctionnées par le Certificat d’Études Primaires Élémentaires (CEPE) en 1939, il fut reçu en 1940 à l’École Primaire Supérieure de Yaoundé où il entra en contact avec les jeunes gens des autres régions avec lesquels il noua de solides amitiés. Ces liens lui ont été d’un grand apport quand il a amorcé sa carrière politique. Après l’École Supérieure de Yaoundé, il entra dans la vie active et servit en qualité de radiotélégraphiste. Ce métier le conduisit à Douala, Ngaoundéré, Yaoundé, Bertoua, Mokolo, et finalement à Garoua où il occupa les fonctions de chef de station. C’est là qu’Ahidjo, retrouvant les siens et ses anciens camarades d’école, forma un noyau dur qui sera le socle de son engagement en politique. Plusieurs auteurs, animés d’une mauvaise foi manifeste ont présenté Ahidjo comme un produit exclusif de la volonté de l’administration politique coloniale française, oubliant ses premiers pas depuis sa prime jeunesse dans le monde associatif, son engagement politique et les différentes batailles électorales qu’il dut mener pour tracer son chemin au plan local, national et jusqu’à l’Assemblée de l’Union française où il siégea parmi les trois conseillers qui représentaient le Cameroun. En 1947, Ahidjo et ses amis créèrent le Cercle de la Bénoué à Garoua, qui fut sa toute première association politique, remplacée dès 1948 par l’association Amicale de la Bénoué (ASSABENOUE). Aux élections du 19 janvier 1947, Ahidjo fut élu délégué de la Bénoué à l’assemblée locale, puis député du Cameroun en octobre de la même année pour l’Assemblée de l’Union Française (AUF). Il n’avait que 23 ans !
En avril 1953, à la première session annuelle de l’ATCAM, Ahidjo était le mieux élu des membres du bureau et de la commission permanente, avec quarante-quatre voix sur quarante-neuf. Le 10 octobre 1953, il a été réélu par l’ATCAM pour représenter le Cameroun à l’AUF comme conseiller. Lorsque l’ATCAM fut remplacée par l’ALCAM à la suite des élections du 23 decembre 1956, Ahidjo était le leader du plus important des quatre groupes qui constituaitent la nouvelle Assemblée : le groupe des Démocrates Camerounais (DC), formé de 20 élus du Centre-Sud et de l’Est dirigé par André-Marie Mbida ; le groupe des Paysans Indépendants (PI), avec 9 élus de la région Bamiléké et avec comme chef de file, Mathias Djoumessi ; le groupe d’Action Nationale du Cameroun(ANC) composé de huit élus et animé par Charles Assalé et Paul Soppo Priso, encore appelé « groupe des huit » ; enfin le groupe d’Union Camerounaise (UC) le plus important de l’Assemblée, avec 30 élus de la région du Nord auxquels s’ajoutent ceux de la région Bamoun, ayant pour chef de file Ahmadou Ahidjo. Dans une assemblée de 70 membres (dont deux sièges non pourvus pour cause d’assassinat des candidats par l’UPC), il constituait logiquement la première force politique. Ahmadou Ahidjo fut élu Président de l’ALCAM avec l’entrée en vigueur du nouveau statut créant l’État sous-tutelle du Cameroun en avril 1957.
Un positionnement politique central à la veille et au lendemain de l’indépendance
Pourtant le 12 mai 1957, c’est André-Marie Mbida qui est désigné comme premier Ministre, Chef du gouvernement par Pierre Messmer, haut-commissaire français de l’époque. Dans ce gouvernement de 15 membres, dont dix ministres et cinq secrétaires d’Etat, Ahidjo occupa le poste de Vice-Premier ministre et Ministre de l’Intérieur. Le 18 février 1958, suite à une crise parlementaire née de l’intransigeance de Mbida à l’égard de l’UPC et à son opposition à l’accession à l’indépendance alors que même la puissance coloniale y était désormais favorable, Ahidjo remplaça Mbida comme Premier Ministre. Le 1er mai 1958 l’UC se constitua en parti politique sous son leadership. Le 24 octobre 1958, l’ALCAM adopta un nouveau texte qui fixait l’indépendance du Cameroun au1er janvier 1960, projet que l’ONU entérina le 13 mars 1959. Avant de disparaître le 31 octobre 1959, l’ALCAM avait donné à Ahidjo les « pleins pouvoirs » à l’issue d’une session parlementaire très houleuse, tenue du 13 au 30 octobre.
Malgré ce parcours d’un homme politique qui s’est forgé face à l’adversité, depuis son milieu familial, l’hostilité d’une bonne partie de l’aristocratie lamidale et la confrontation avec les principaux leaders de la politique camerounaise de la veille et d’après l’indépendance, des auteurs continuent à considérer Ahidjo comme un outsider de la politique et à feindre l’étonnement. Quelle marque et quelle preuve de mauvaise foi, démentie par sa remarquable trajectoire historique, gravissant étape par étape toutes les marches jusqu’au sommet de l’Etat et de la notoriété internationale. Le contexte de l’accession à l’indépendance est également peu pris en compte dans l’analyse pour expliquer le comment et le pourquoi de la prise d’un certain nombre de décisions et de textes jugés répressifs, juste pour les besoins de mise en place d’une autocratie. Quid de la poursuite des exactions et des opérations de terreur à travers certaines parties du pays malgré la proclamation de l’indépendance, sous le prétexte de rechercher la vraie indépendance, au prix des tueries de nos compatriotes. C’est pourquoi il est logique de se demander où se situe la frontière entre le nationalisme et le banditisme pour ceux qui ont continué la lutte au lendemain de l’indépendance en 1960. Dans quel registre situer les exactions conduites par Ernest Ouandie (Ouest et Littoral) ou Osende Afana (Sud-est) ? Sûrement pas du nationalisme simplement comme le témoigne les débats en cours à ce sujet. L’alignement systématique sur les thèses propagées par l’UPC a fait perdre la distance critique à plusieurs analystes de la période.
Quand l'UPC entre au maquis en 1955, c’est un parti conçu sur le modèle du parti communiste soviétique et géré par un secrétaire général moulé dans la méthodologie de travail calviniste. La guerre et la clandestinité n'ont pas tout à fait supprimé ces dispositions structurelles. Dans sa genèse tout comme dans ses amitiés, l’UPC est demeurée communiste. Son emblème le traduit d’ailleurs si bien avec la couleur rouge entourant le crabe noir, symbole prémonitoire de ses divisions et inimitiés observables encore aujourd’hui. Cette proximité avec le monde progressiste, communiste ou socialiste, est compréhensible dans un contexte de guerre froide et d’affrontements est-ouest qui prévalait à sa naissance. Pourtant les Upécistes et leurs analystes ont toujours affirmé le caractère non communiste du parti, alors même que tous les indices y convergent. Peut-être que cette clarification n’entrait pas dans le cahier des charges de la Commission, mais il est permis de questionner ce positionnement univoque épousant la vision de l’UPC.
De même, le rapport n’a pas apporté un seul document étayant l’accusation d’anti-nationalisme d’Ahidjo ou même une seule déclaration démontrant son opposition à l’accession à l’indépendance du Cameroun. Au contraire d’un André-Marie Mbida, pourtant mieux vu, dont l’extrémisme des positions à l’égard de l’UPC et l’opposition à l’accession du Cameroun à l’indépendance est bien connue et documentée. Avant comme après l’indépendance, l’action d’Ahmadou Ahidjo s’est inscrite dans la recherche de l’unité nationale et la construction d’un Cameroun fort et prospère, traçant sa propre voie. La coopération avec la France, n’a en rien enlevé ses capacités à prendre des positions et à adopter des décisions dans l’intérêt exclusif du Cameroun.
Une défiance intelligente à l’endroit de la France
Beaucoup d’analystes et le plus souvent parmi ses détracteurs l’ont présenté comme ayant été imposé par la France dont il serait le jouet et l’instrument de sa politique. Il est indéniable que l’histoire lui rendra justice au regard des positions et des attitudes courageuses qu’il a toujours eues, dès lors que les intérêts de son pays étaient sur la balance. Il est tout d’abord étonnant de constater que le Cameroun est resté le seul pays d’Afrique francophone à n’avoir jamais accepté d’abriter les bases militaires françaises. Pourtant sa position géographique est meilleure que celle de tous les autres pays pour celui qui voudrait contrôler militairement les différentes régions de l’Afrique. Sa position centrale et presque à équidistance de toutes les autres parties du continent n’a pas été sans attirer des convoitises. Mais contrairement à ses autres pairs qui nourrissaient une certaine phobie des coups d’Etat, Ahidjo n’a jamais donné cette opportunité à la France du Général de Gaulle et à ses successeurs. Son nationalisme sourcilleux et son panafricanisme a impressionné davantage les observateurs lorsqu’Ahidjo a opposé son refus au Général de Gaulle qui voulait utiliser le Cameroun comme base-arrière et de soutien aux insurgés lors de la guerre de sécession du Biafra en 1967. On peut y ajouter sa décision de quitter la compagnie aérienne Air-Afrique soutenue par la France pour créer la propre compagnie nationale camerounaise, la Cameroon-Airlines (CAMAIR) en 1977, pour affirmer la souveraineté de son pays et garantir ses plus hauts intérêts au plan international. Il est indéniable qu’Ahmadou Ahidjo a posé les fondations de l’Etat moderne du Cameroun, dans un contexte particulièrement difficile et complexe, en l’absence de moyens matériels et humains, à la hauteur des immenses défis qu’il avait à relever. De la colonisation il hérita d’un pays déchiré à propos de la lutte pour l’indépendance, économiquement faible et dont il fallait asseoir l’armature administrative et impulser le développement.
Que faut-il en retenir ?
Ce rapport-livre est un chef d’œuvre d’érudition sur l’histoire du Cameroun en ce qui concerne la période considérée. Mais en privilégiant une vaste érudition, il a occulté sciemment le volet accès et restitution des archives du Cameroun, pour permettre une écriture dépassionnée de cet épisode historique. Certes, on nous promet un volet mémoriel sous la houlette du chanteur Blick Bassy, celui-là même dont la présence à la co-présidence de la Commission a hérissé plus d’un historien camerounais, dont le Président de la Société Camerounaise d’Histoire, le regretté Professeur Daniel Abwa, parti avant le rendu de ce rapport Ramondy. Ce rapport comporte des lacunes méthodologiques importantes et des silences qu’il importe de combler rapidement, notamment un biais historiographique, qui repose essentiellement sur des sources françaises et des auteurs critiques d'Ahidjo : une absence criarde des voix du Nord-Cameroun, région pourtant essentielle dans cette période ; une analyse du néocolonialisme très réductrice, ne prenant pas en compte les actions souveraines du régime Ahidjo contraires aux positions françaises dans un contexte géopolitique ou stratégique très polarisé.
Dès son origine la démarche est asymétrique et peu soucieuse de la partie camerounaise qui a tout juste laissé faire, sans s’y impliquer à la hauteur des attentes. Cela cache mal une opération de réhabilitation de l’image de la France en la déresponsabilisant et en accablant les autorités du Cameroun post-indépendance, à travers le peu d’accès aux archives inédites, des archives déclassifiées mais sans intérêt ou révélations majeures, une occultation de la chaîne de commandement en voilant les donneurs d’ordre au niveau politique, une narration atténuée des responsabilités françaises à travers la sélection de certaines archives, une synthèse partielle des faits déjà connus, l’impression d’une démarche paternaliste qui empêche une pleine autonomie camerounaise dans la construction de son propre narratif historique, un dialogue déséquilibré marginalisant ou n’ayant pas pris en compte les attentes camerounaises et surtout, la confiscation illégale des archives camerounaises, faisant craindre la destruction ou la disparition de certaines qui seraient compromettantes pour la France.
Partie sur un malentendu quant à ses objectifs et son agenda initial, cette commission a rendu son rapport sans lever les attentes premières. A tout point de vue, il ne s’agissait pas d’un Comité pour la rédaction de l’histoire du Cameroun entre 1945 et 1971. Ce qui était attendu portait sur l’accès aux archives de cette période à tous, sans entrave, afin que l’histoire puisse s’écrire. En refusant l’ouverture des archives et leur transfert au Cameroun, la France a choisi délibérément de continuer à empêcher une reconstruction complète et autonome de l’histoire camerounaise, de contrôler sa mémoire historique et d’être un obstacle pour la recherche de la vérité et d’effacer les preuves critiques pouvant l’incriminer. Cet accès limité aux archives et ce manque de volonté de leur restitution sont de nature à compromettre les actions en justice et les réparations qui pourraient être réclamées de la part des familles des victimes, en plus de la reconnaissance des préjudices subis. Une réconciliation véritable entre les deux pays nécessiterait une restitution des archives tout comme les autres biens culturels volés ou détenus illégalement, un accès égalitaire à toutes les sources en plus d’une reconnaissance pleine et entière des injustices historiques commises. Il n’est pas superflu de revenir à l’agenda initial, celui de l’accès aux archives françaises et camerounaises, à toutes les archives de la période considérée, loin de la rédaction d’un livre d’histoire pour les Camerounais. La reconnaissance de la responsabilité française sur ses exactions coloniales devra déboucher sur les inévitables réparations.
Bibliographie indicative
ALCANTARA, A. (2008). Le Cameroun sous tutelle française : Stratégies politiques et résistances locales (1946-1960). Paris : Karthala.
ATANGANA, M. (2010). French Investment and African Imperialism: The Case of Cameroon, 1914-1960. Oxford : James Currey.
MAIMOUNATOU, (2018). « Ahmadou Ahidjo et le Nord-Cameroun, 1946-1982 », Thèse de Doctorat/Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I.
MBEMBE, A. (1996). La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960). Paris : Karthala.
NGO, V. J. (1984). Histoire du Cameroun : Des origines à nos jours. Yaoundé : CEPER.
RAMONDY, K. s/dir. (2025). Rapport du volet « Recherche », Commission franco-camerounaise sur le rôle et l’engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d’opposition entre 1945 et 1971, 2 volumes, 1069 pages.
TOUKO TSOKI, E. (2018). Ahmadou Ahidjo : L'homme, le pouvoir et l'héritage politique. Dakar : NEA.
À propos
L'IRES a pour but de produire des solutions politiques innovantes et transformatrices du Cameroun et de l'Afrique en général.
Contact
© IRES 2024
Tel: +32 486 106100
